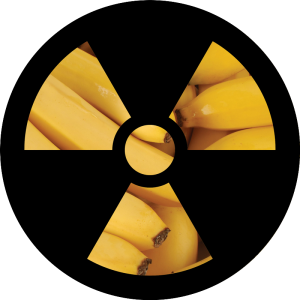De cette interpellation naquit toute une série de threads, puis ce billet.
Ce même jour, par chance, la production éolienne en France était généreuse et relativement stable, et prévue pour le demeurer jusqu’à la fin de la journée. Quant au solaire, il se comportait comme du solaire.

Ceci incite toutefois, dirait probablement un « vrai ingénieur », à demander aux gens de ne pas se lever avant 9 ou 10h du matin, afin de profiter de l’ensoleillement pour faire fonctionner micro-ondes, grille-pains et sèches-cheveux. Ou même RER, métro et trains.
Et le même jour, il aurait été avisé de ne pas faire la cuisine pour le dîner après 16 ou 17h, pour les mêmes raisons.
Pour aller plus loin, dans les jours qui suivirent, j’ai, chaque matin, regardé les prévisions de production éolienne et solaire du même jour, ainsi que les prévisions de consommation, et les recommandations pour modifier la seconde pour la rapprocher de la première.
Une sorte de « météo de l’électricité », qui pourrait devenir la solution de « vrais ingénieurs » pour que la consommation devienne davantage flexible par rapport à la production : dire aux gens comment faire, chaque jour, voire ce qu’ils peuvent faire.
Pour voir les différents graphiques et les prévisions de consommation associées, c’est dans le thread Twitter uniquement, pas repris dans ce billet de blog :
Rétrospective sur une semaine:
Le chemin avant d’adapter la consommation à la production, et non plus l’inverse comme c’est le cas depuis un siècle, est extrêmement long et compliqué. Il ne suffira pas de stocker à midi ou à quatre heures du matin et déstocker lors des pics de consommation du matin et du soir. Il faut également prévoir de stocker le week-end et déstocker tout au long de la semaine. Et, même si ça ne paraît pas dans ces graphiques, il faut en plus être en mesure de stocker et déstocker d’une saison à l’autre.
Ces différentes échelles de temps pour stocker l’électricité, elles sont déjà d’actualité. Le stockage de l’électricité sous forme gravitaire hydraulique (les STEP) est décliné en deux modes de fonctionnement.
- Les petites STEP de faibles capacités mais nombreuses et donc qui cumulent une forte puissance (mais de toujours faibles réserves) fonctionnent essentiellement en cycle jour/nuit : l’eau est pompée en heure creuse vers l’amont, et turbinée vers l’aval au pics de consommation du matin et du soir.
- Les quelques énormes STEP contribuent aussi au cycle jour/nuit, mais sont surtout sollicitées pour être remplies le week-end, car la consommation est faible, et turbiner toute la semaine, toujours lors des pics de consommation.
Quant au stockage d’une saison à l’autre, ce sont l’atmosphère, l’océans et les montagnes (les glaciers surtout) qui s’en chargent. L’hiver, les précipitations plus abondantes permettent au centrales hydroélectriques « au fil de l’eau » de rencontrer un débit plus important et donc de produire davantage que l’été ; et les lacs, remplis pendant la fonte des glaces, se vident en turbinant cette eau l’hiver pour combler nos besoins.
L’éolien et le solaire, eux, subissent tout cela, sans que cela ne soit optimisé pour nos besoins.
Toutefois, à la même période, j’expérimentais de m’adapter à la production éolienne et solaire. Et ça marche, sans trop d’effort…

Mais uniquement en considérant les moyennes journalières, et certainement pas au cours de la journée !
Et le jeu des prévisions météo a continué quelques jours. Dans un seul but : rendre visible ce qu’on appelle « intermittence », et montrer à quel point adapter la consommation demande davantage que de « vrais ingénieurs » ou juste de la « volonté politique ».