Dans cet article, dont vous retrouverez la version thread Twitter ci-après, je vous propose une petite rétrospective maison du processus réglementaire et scientifique de la gestion des déchets radioactifs aujourd’hui dédiés au stockage géologique : ceux de haute activité ainsi que ceux de moyenne activité à vie longue. Pourquoi ? Parce que les politiques, décennies après décennie, n’ont eu vocation qu’à repousser la prise de décision, comme vous allez pouvoir le constater, et donc nourrir la fausse idée selon laquelle on ne saurait « pas gérer les déchets radioactifs »…
1991
Le Parlement demande au CEA, au CNRS et à l’ANDRA d’étudier diverses solutions pour gérer au long terme les déchets les plus radioactifs. La feuille de route leur donne 15 ans pour rendre leur copie. On se référera à ce point de départ comme la « Loi Bataille », et Alexis a quelques anecdotes à son sujet.
L’article 4 de cette loi est celui qui nous intéresse ici.
« Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l’avancée des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
- la recherche de solutions permettant la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
- l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
- l’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l’étranger.
À l’issue d’une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d’évaluation accompagné d’un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d’un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
Le Parlement saisit de ces rapports l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Ainsi, lors de ce point zéro, il était bien question d’étudier différentes alternatives et, si le stockage géologique devait ressortir comme l’option la plus crédible, se préparer dès 2006 à la création d’un centre de stockage. Notons également qu’il était déjà alors question d’éventuelle réversibilité du stockage géologique.
Toujours 1991
La DSIN, qui deviendra plus tard l’ASN, édicte la « Règle fondamentale de sûreté » (RFS) III.2.f qui définit les objectifs à retenir pour le stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde.
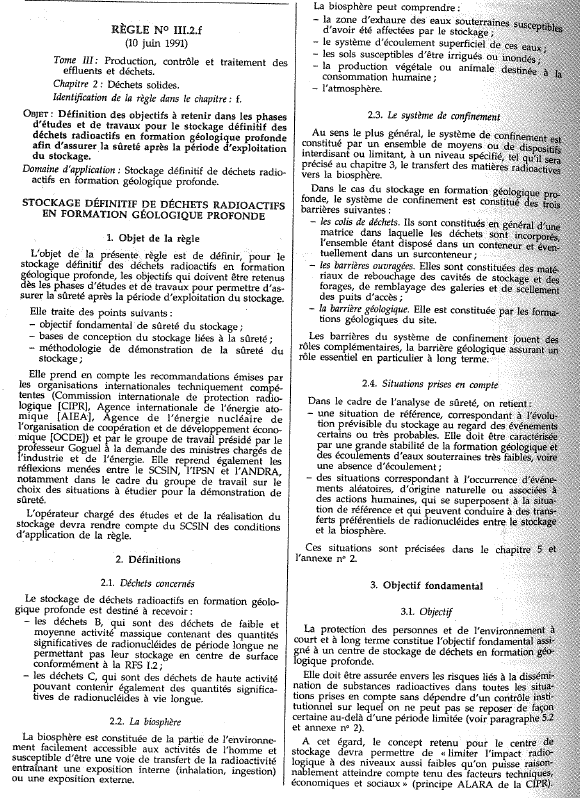
2005
L’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des matières et déchets radioactifs, remet le « Dossier argile ». Celui-ci prétend aboutir à la conclusion qu’un stockage de déchets radioactifs dans la couche argileuse où le laboratoire est déjà implanté est faisable.

Ce dossier fait l’objet d’une instruction par l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En deux mots, le stockage y est qualifié de « faisable » et le dossier ne présente pas « d’élément rédhibitoire ». Et donc si une décision parlementaire devait être prise en 2006 en faveur du stockage géologique, l’IRSN juge que les données disponibles le justifieraient.
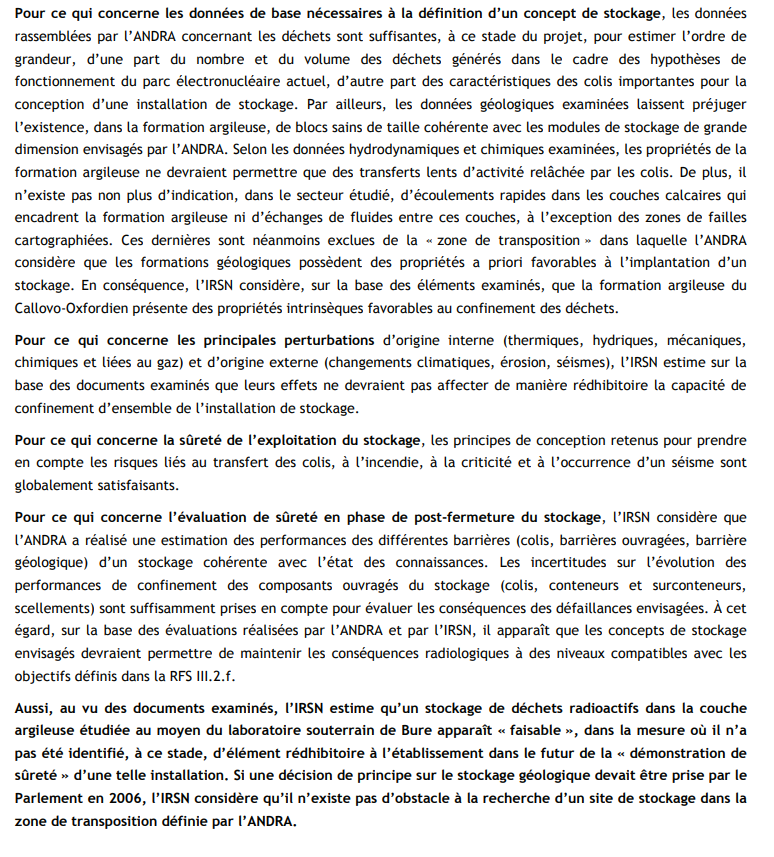
Cet avis de l’IRSN est alors présenté au « Groupe permanent d’experts de l’ASN pour les installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs. » Ce groupe conclut :
Des résultats majeurs relatifs à la faisabilité et à la sûreté d’un stockage ont été acquis.
2006
Tous les experts ont rendu leur avis sur le stockage géologique. À l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, de trancher. Puis viendra le tour pour le Gouvernement et le Parlement de se décider.
L’ASN considère que le stockage en formation géologique profonde est une solution de gestion définitive qui apparaît incontournable.
Avis de l’ASN sur les recherches relatives à la gestion des déchets à haute activité et à vie longue

C’est sans ambiguïté et un appel du pied explicite au Parlement.
Lequel, toujours en 2006, trouve malgré tout que ces quinze années sont passées drôlement vite, et que l’on ne serait toujours pas en mesure de décider. La décision est repoussée à 2012, et les études et recherches vont pouvoir continuer. L’ANDRA prend notamment alors en charge les recherches sur l’entreposage de longue durée.
L’article 3 de la loi 2006-739 du 28 juin 2006 propose d’approfondir toujours les trois mêmes axes de recherche :
- « La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue. Les études et recherches correspondantes sont conduites en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires […] afin de disposer, en 2012, d’une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de mettre en exploitation un prototype d’installation avant le 31 décembre 2020 ;
- Le stockage réversible en couche géologique profonde. Les études et recherches correspondantes sont conduites en vue de choisir un site et de concevoir un centre de stockage de sorte que, au vu des résultats des études conduites, la demande de son autorisation […] puisse être instruite en 2015 et, sous reserve de cette autorisation, le centre mis en exploitation en 2025 ;
- L’entreposage. Les études et recherches correspondantes sont conduites en vue, au plus tard en 2015, de créer de nouvelles installations d’entreposage ou de modifier des installations existantes, pour répondre aux besoins, notamment en termes de capacité et de durée […]. »
Que voit-on ? Que l’on repart pour un tour, déjà, sur avis du Parlement, contre celui de l’Autorité de sûreté, n’en déplaise à ceux qui crient à la technocratie ou à l’absence de démocratique en la matière. L’on voit aussi apparu que le stockage doit à présent être réversible. Et on note des dates qui, vues de 2022, nous font bien rire : un prototype d’installation de séparation ou transmutation avant fin 2020 quand Astrid a été abandonné en 2019, ou une demande d’autorisation de création de Cigéo en 2015 quand on l’attend pour 2023 ou 2024…
2008
La RFS III.2.f est abrogée par l’ASN qui la remplace par un « guide », le premier guide de l’ASN, sur le stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde.

2009
L’ANDRA présente un rapport d’étape sur Cigéo, marquant le passage d’une phase de faisabilité à une phase d’avant-projet.

2010
Le CEA, alors encore Commissariat à l’énergie atomique, présente un rapport d’étape sur l’évaluation technico-économique des perspectives industrielles des filières de séparation et transmutation des substances radioactives à vies longues.
2012
Sur cette base, l’IRSN rend un avis sur la séparation/transmutation. L’institut y déclare que la faisabilité n’est « pas acquise » et que les gains espérés, y compris en termes de sûreté, « n’apparaissent pas décisifs. »

Toujours 2012
Le CEA complète son rapport d’étape d’un rapport complet sur la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue, au titre de la Loi Bataille de 1991.

L’ANDRA est également à l’heure au rendez-vous et livre son bilan des études et des recherches sur l’entreposage et conclut que cette solution constitue un soutien au stockage géologique plus qu’une alternative.

2013
L’ASN s’appuie sur les deux rapports du CEA et sur l’avis de l’IRSN et conclut sur la transmutation : cette option ne devra pas être « un critère déterminant pour le choix des technologies examinées ».

Côté État, on se lance dans un débat public avant de trancher, et c’est de manière assez prévisible, l’option du stockage géologique qui en ressort.
2016
Forte fut la procrastination, mais cette année-là, le Parlement, et à une très grande majorité, vote l’adoption du stockage géologique comme solution de référence.
La loi 2016-1015 du 25 juillet 2016 précise « les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue ».
La même année, l’ANDRA dépose auprès de l’IRSN, pour instruction, les deux Dossiers d’options de sûreté (DOS) de Cigéo, pour les phases d’exploitation et post-fermeture.

L’ANDRA saisit également l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’AIEA, pour demander une revue internationale sur les DOS. Celle-ci rendra rapidement ses conclusions : projet robuste, méthode adaptée. La revue internationale suggèrera des thématiques à investiguer davantage.
Le contenu du DOS et les discussions engagées au cours de la mission ont donné à l’équipe de revue une assurance raisonnable quant à la robustesse du concept de stockage. Constatant que, dans de nombreux domaines, la recherche est toujours en cours pour la démonstration ou la confirmation de la sûreté, l’ERI a identifié quelques domaines supplémentaires qu’il serait utile d’approfondir, afin de renforcer la confiance existante dans la démonstration de sûreté : production et transport des gaz, description du vieillissement des composants du centre de stockage au cours de la période d’exploitation, incertitudes liées au temps de resaturation des alvéoles de stockage et effet sur la dégradation des colis de déchets, rôle des microbes et formation potentielle de biofilms au cours de la période d’exploitation, et conséquences des défaillances non détectées.
Les DOS sont également instruits par la Commission nationale d’évaluation qui en restituera une analyse et des recommandations pour améliorer le projet.

2017
À son tour, l’IRSN rend la sentence de ses experts sur le DOS. Le projet fait état d’une « maturité technique satisfaisante au stade du DOS », mais il demeure des points durs. En particulier, la démonstration de maîtrise du risque d’incendie pour une certaine une famille de déchets de moyenne activité est insatisfaisante. Si cela n’est pas rédhibitoire pour l’avancement du projet Cigéo, pour ces déchets, pas de stockage possible en l’état, les études doivent continuer. Soit en vue d’une amélioration de la démonstration de sûreté, soit en vue d’un reconditionnement des déchets pour neutraliser leur réactivité chimique.

Les Groupes permanents d’experts de l’ASN pour les installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs et pour les laboratoires et usines du cycle vont dans le même sens que l’IRSN :
En conclusion, les groupes permanents estiment que le DOS transmis par l’ANDRA montre que les options de sûreté de Cigéo sont dans l’ensemble satisfaisantes, hormis le cas particulier des bitumes. Sur cette base et compte tenu des engagements pris par l’ANDRA, une démonstration probante de la sûreté du projet de stockage devrait pouvoir être présentée dans le dossier de demande d’autorisation de création correspondant, sous réserve d’un traitement satisfaisant des points soulevés dans le présent avis, dont certains pourraient nécessiter des modifications d’éléments de conception.
2018
L’ASN rend son avis sur le DOS et le soumet à consultation du public. Bilan : « maturité satisfaisante » à ce stade. L’ASN reprend certaines recommandations précédemment émises pour les étapes futures (lesquelles seront la Déclaration d’utilité publique, attendue en 2022, et le Décret d’autorisation de création, dont la demande est prévue pour 2023 ou 2024).

La même année, une commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires soumet un rapport qui préconise de « poursuivre l’étude de la solution de l’entreposage de longue durée en subsurface comme alternative éventuelle au stockage géologique. » Et ce en dépit de tous les acquis précédents contestant la pertinence de l’entreposage comme alternative, motivé par les seules postures de militants antinucléaires.

2019
La députée LREM Émilie Cariou, rapporteure du débat public susmentionné, propose l’entreposage comme alternative au stockage géologique. En tirant, là encore, un trait sur les travaux scientifiques et parlementaires depuis 1991.

La même année, la Commission nationale du débat public, dans le cadre du débat public sur le PNGMDR 2019-2021, demande à l’IRSN une revue bibliographique des recherches internationales sur les alternatives au stockage géologique. L’IRSN répond à cette demande, j’en parlais dans cette série d’articles. Je résumais ainsi l’avis IRSN :
- Arrêter de produire des déchets ainsi que l’entreposage en (sub)surface ne sont pas retenus car, par essence, ils ne sont pas des alternatives au stockage géologique.
- De même pour la séparation-transmutation, qui est au mieux un complément, pas une alternative.
- L’immersion et le stockage dans les glaces polaires ont des limites techniques sérieuses et, surtout, des verrous politiques et éthiques.
- L’envoi dans l’espace est une catastrophe en termes de sûreté et de coût.
- Le stockage en forage a un potentiel très intéressant pour certains déchets, plus discutable pour d’autres mais sans problème majeur.
2020
L’ANDRA publie son dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
2021
La Commission d’enquête sur la demande de reconnaissance d’utilité publique du projet Cigéo rend son rapport. En résumé :
La commission d’enquête considère que le projet est à la fois opportun, pertinent et robuste au regard des textes réglementaires qui stipulent un stockage des déchets en couche géologique profonde sur un site disposant d’un laboratoire souterrain.
Au terme de ce bilan entre d’une part le risque, et d’autre part les mesures de précaution la
commission d’enquête estime la proportionnalité acquise et pertinente.
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de centre de stockage en couche géologique profonde des déchets de haute et moyenne activité à vie longue (Cigéo), assorti de CINQ recommandations ci-après.
Les cinq recommandations sont les suivantes ;
- D’établir un échéancier prudent des aménagements préalables dans l’occurrence de l’obtention des
autorisations ; - De veiller à une insertion paysagère harmonieuse avec le paysage rural ;
- De procéder à un défrichement progressif du bois Lejuc, aux seuls besoins de la DRAC afin de
préserver au maximum la biodiversité ; - De maintenir un écran visuel sur la partie sud pour préserver les vues depuis les villages
environnants ; - De compléter la communication envers le public de son territoire proche et l’adapter en fonction
de la phase opérationnelle de Cigéo, tout en reconnaissant l’importance de la communication déjà
réalisée par le maître d’ouvrage.
Toutefois, en parallèle, la Banque publique d’investissement (BPI) lance un appel à projets appelant à chercher des solutions alternatives au stockage géologique profond.
Conclusion
Ce thread débute en 1991. La décision devait être prise en 2006. Elle a été repoussée jusqu’en 2016, pour des raisons… Variables, souvent politiques. Depuis, toutes les étapes ont conforté la décision faite alors. Et pourtant, 30 ans après la loi de 1991, 15 ans après la loi de 2006, on n’a pas encore mis le premier coup de pelle pour Cigéo. On repousse…
Et surtout, les décideurs (ça te va, les décideurs ?) font énormément d’efforts… Pour ne pas décider ni devoir décider, pour revenir en arrière, remettre en question les décisions et acquis précédents, essayer encore et encore de nous faire repartir vers 1991.
C’est pour cela qu’il est encore si facile de clamer « on sait pas quoi faire des déchets » ! Si, on sait quoi faire, depuis 15 ans, et chaque jour depuis, on sait un peu mieux. Mais on procrastine. Les opposants n’ont évidemment pas intérêt à encourager la prise de décision. Les élus… Pareil. Le statu quo est confortable, devoir s’engager sur un tel sujet est terrifiant. Chacun lègue à la « génération » (électorale) future.
Et encore, ma chronologie est ultra franco-centrée ! Mais la démarche parallèle a lieu dans des tas de pays, et les résultats sont cohérents !
Dans ce thread ci-dessous, je décortiquais un rapport de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. Son joli nom : Management and Disposal of High-Level Radioactive Waste : Global Progress and Solutions.
Les optimistes me rétorqueront que la recherche sur les alternatives est nécessaire pour justifier de l’intérêt de la réversibilité du stockage géologique, et pour l’acceptation par les politiques et le public, et qu’elles n’empêchent pas le projet d’avancer. En effet, l’idée d’avoir un stockage réversible pendant environ un siècle est de pouvoir changer d’avis si une alternative émergeait d’ici là. Donc, évidemment, il faut chercher des alternatives, quand bien même sait-on qu’il n’y a rien à espérer qui remettrait en question la pertinence du choix du stockage géologique.
J’espère seulement qu’effectivement, ces errements ne freineront pas à nouveau le projet, et que les différentes formations politiques au pouvoir se garderont de nous renvoyer sans cesse en 1991 à vouloir étudier les alternatives, encore et encore, avant de prendre une décision.
Les clés pour décider, on les a déjà. L’enquête pour la DUP de Cigéo est bouclée et, d’ici deux ou trois ans viendra celle pour le Décret d’autorisation de création. Le moment ultime de prendre cette lourde décision.
Le processus accompagnera le mandat du Président élu en 2022 et le Décret d’autorisation de création pourrait être prêt en toute fin de mandat, donc à la veille d’une échéance électorale. Que faut-il attendre ? En tout cas, je pense que ce thread le montre assez bien, il n’y aura, sauf révélation majeure, aucune raison d’encore procrastiner. Alors, que fera-t-on ?
Je vous laisse entre les mains du Président de l’ASN. Parce qu’il a l’intelligence d’être d’accord avec moi.
(Joke, hein)


